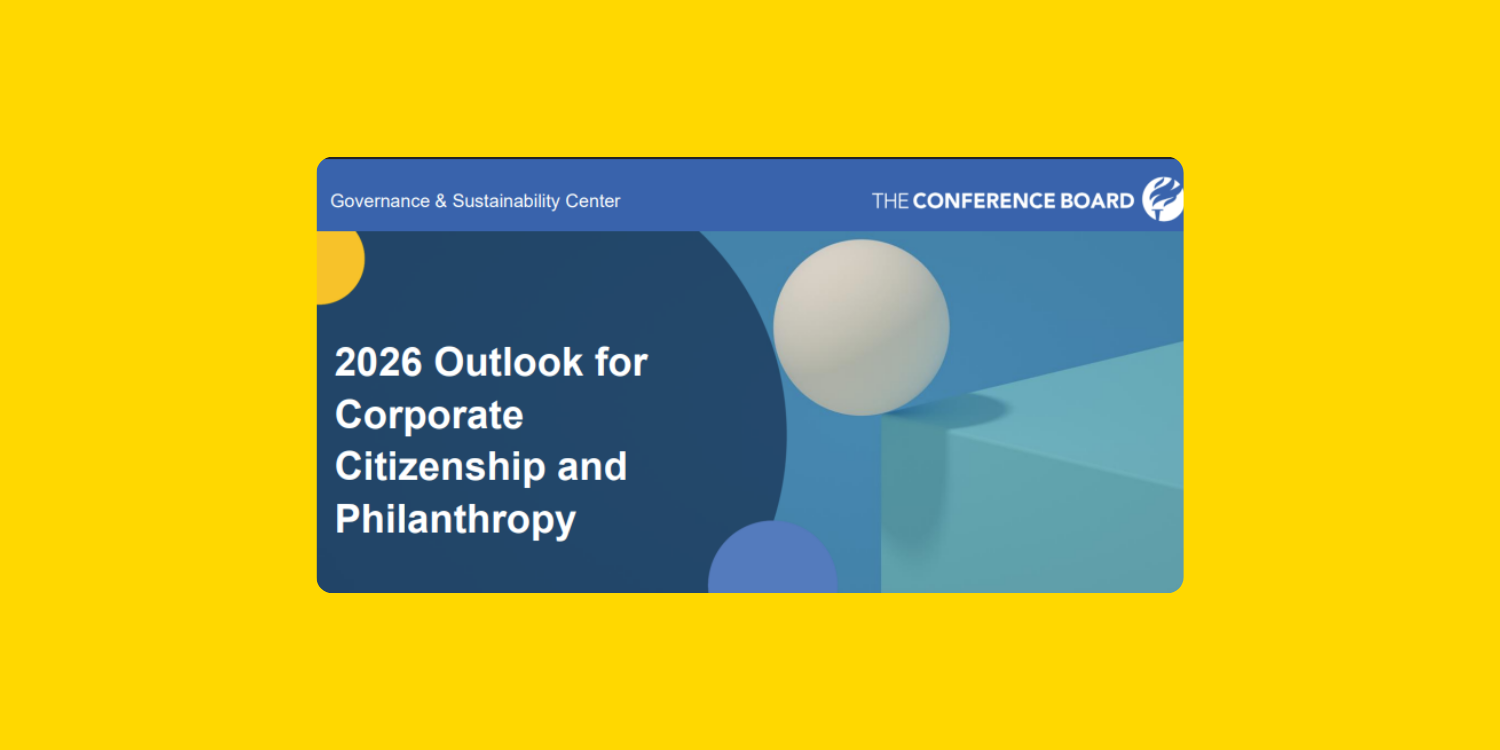La veille de l’AFF du 03 avril 2025
1 avril 2025
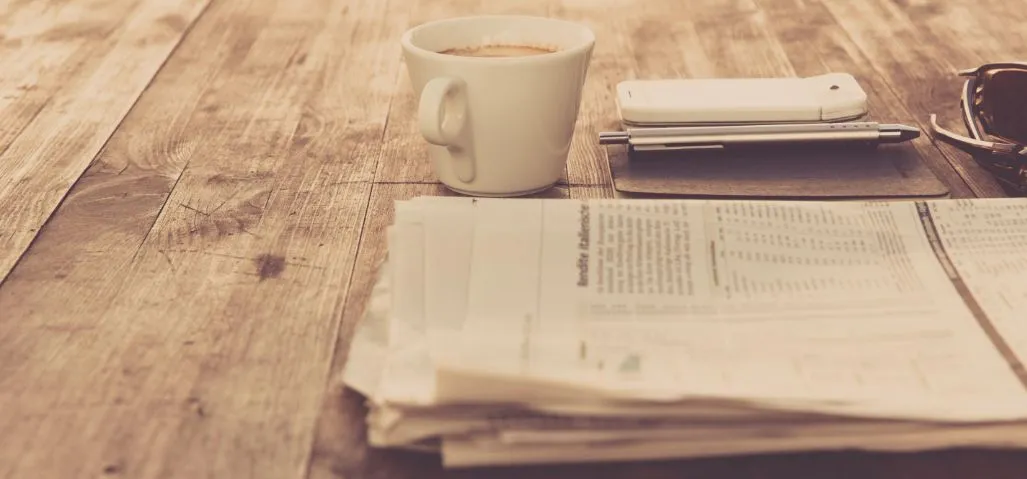
Veille issue de la Newsletter du 03 avril 2025
Belgique : le secteur associatif se mobilise largement contre la baisse quasi certaine de la déductibilité des dons
La nouvelle est tombée sans crier gare fin janvier. Dans la presse, le secteur sans but lucratif belge découvre le projet de la nouvelle coalition de gouvernement dite « Arizona » prévoyant de réduire la déductibilité des dons de 45% à 30%… Les échanges avec des députés confirment le projet, à considérer comme un moindre mal puisque « deux ou trois semaines auparavant, la suppression pure et simple de la déductibilité fiscale pour des dons était sur la table des négociateurs », raconte à l’AFF Erik Todts, Président de l’association RE-EF (Récolte de fonds Ethique), qui contribue à la coordination du mouvement de mobilisation du secteur caritatif belge.
Début février, la mesure est confirmée par la publication d’une déclaration gouvernementale. Elle est incluse dans une « loi programme » portant des dispositions fiscales diverses, qui doit être débattue en commission et approuvée par la Chambre des représentants belges. Pour faire pression sur ses députés, le secteur se mobilise à commencer par la publication d’une tribune signée par 470 associations. Depuis quelques jours, la mobilisation s’étend sur les réseaux sociaux avec le #Support Generosity, et un site éponyme pour porter le mouvement, ainsi qu’en affichage avec l’interpellation « -15% de dons, c’est rien ? ».
Mais l’espoir semble mince. « Nous pouvons craindre un processus rapide », explique Erik Todts. La réduction à 30% est quasi certaine car aucun parti de la majorité ne montre son intention de s’y opposer. A ce stade, le vrai enjeu du passage du projet de loi par la Chambre des représentants est le retrait de la rétroactivité de la mesure pour les dons dès le 1 janvier 2025… ».
Alors que l’association RE-EF est en train de collecter les impacts redoutés sur la collecte auprès des associations, un sondage publié par Sudinfo.be révèle que 35% des donateurs affirment qu’ils risquent d’arrêter leurs dons si la loi passe, que 26% pensent qu’ils les maintiendront au même niveau et 22% qu’ils donneront moins. Le secteur anticiperait une baisse de 10 à 20% de la générosité, soit 35 à 70 millions d’euros de générosité en moins pour un pays (les dons des belges étaient d’environ 350M€ l’an dernier). Cela pour une mesure qui pourrait permettre au gouvernement de faire 50 à 55 millions d’euros d’économies budgétaires, soit « des économies de bouts de chandelles » face à un risque important pour la générosité martèle une Directrice d’Amnesty International sur le site de l’association.
IA plus qu’à ? Où en sont les associations avec l’IA ?
Alors que le secteur non profit n’a pas la réputation d’être le plus avancé sur le sujet de l’IA en France, France générosités publie une étude sur la progression de l’IA chez ses associations et fondations membres : usages, freins et opportunités à leur développement, ou questions éthiques. Premier enseignement 57% des associations auraient une « attitude proactive » sur le sujet, note France Générosités (avec quand même 47% « en cours de réflexion » et 20% ayant commencé ou aboutit le déploiement d’outils).
Usage principal de l’IA : la rédaction (mais à l’AFF ce sont encore des humains qui se chargent de votre newsletter !). Ainsi, 82% des sondés s’en servent pour leurs rapports, lettres d’information, articles, outils de traduction… Pas étonnant, alors que 44% des répondants viennent de services communication/digital/marketing et 20% de services collecte/libéralités (au total 228 professionnels issus de l’ensemble des fonctions support de 112 associations et fondations ont répondu à l’étude menée fin 2024, voir ici le rapport complet).
La rédaction figure ainsi loin devant la veille / recherche d’informations (48 %) ou les outils de communication (contenu personnalisé, réseaux sociaux, visuels). 10% utilisent l’IA dans le cadre de leur stratégie de collecte (analyse des données, analyse des comportements donateurs, identification de cibles stratégiques…). A noter que selon une étude Hubspot (menée sur des marketeurs uniquement) en 2023, les quatre principales utilisations de l’IA génératrice chez les spécialistes du marketing rejoignaient ces priorités : création de contenu (48%), analyse/rapport sur les données (45%) et la réalisation de recherches (32%).
Un point d’unanimité (ou presque) émerge de l’étude : 99 % des sondés estiment que l’IA est une opportunité pour le secteur de la générosité et 91 % affirment qu’elle peut être utile dans le cadre de leur travail, pour améliorer globalement l’efficacité de l’organisation. Mais on est loin de l’adoption organisationnelle : 83 % des salariés répondants utilisent l’IA au sein de leur organisation mais seulement 22 % à titre collectif (au sein du service à 12 % et au sein de l’ensemble de l’organisation à 10 %). Les freins à ce déploiement global ? Pour 56% des répondants, ils viennent de la difficulté à comprendre ou à implémenter les outils d’IA (manque de compétences en interne pour se saisir du sujet), pour 33% du manque d’acculturation ou de la défiance de la gouvernance. Enfin, 25% évoquent la difficulté à trouver un outil répondant aux normes éthiques de leur organisation.
L’éthique et la maîtrise de l’IA sont ainsi deux points d’interrogation et de pivot pour une adoption plus massive de l’IA dans les associations. Alors que 85 % des répondants au sondage affirment exercer un contrôle systématique sur les résultats produits par l’IA, ils sont aussi 56% à estimer qu’il y a des risques éthiques à l’usage de l’IA au sein de leur organisation (12% estimant que ces risques n’existent pas). Pour répondre à ces enjeux, seules 5 des 112 organisations auraient à ce stade mis en place une charte éthique ou une politique d’usage dédiée à l’IA et 17% indiquent qu’une démarche de ce type est en cours au sein de leur structure.
Appel au don « guerrier » pour Greenpeace USA
Amère amende… Aux USA, l’association Greenpeace a été condamnée par la justice à verser la colossale somme 665 millions de dollars de dommages et intérêt à la compagnie Energy Transfer, rapporte notamment le journal Les Echos. L’ONG était mise en cause pour s’être mobilisée contre la construction de l’oléoduc Dakota Access Pipeline et d’avoir soutenu les populations autochtones en 2016-2017.
Alors que l’association a fait appel de sa condamnation au titre de diffamation, atteinte à la réputation et entrave à la levée de fonds auprès d’investisseurs (voir ici sur le Club des Juristes, l’analyse détaillée de la condamnation), Greenpeace fait aussi appel à ses donateurs pour abonder son Warrior Defense Fund, nommé d’après l’iconique Rainbow Warrior. Un fonds destiné à financer ses frais juridiques ou aussi la sécurité de ses personnels impliqués dans l’affaire. « Soyez un guerrier ! » (Be a warrior) invite-telle pour mobiliser les soutiens.
En France, pour mémoire, à l’automne un projet visant au retrait des avantages fiscaux des associations condamnées pour diffamation ou introduction dans le domicile d’autrui avait été proposé, avec au centre du viseur l’action de certaines associations environnementales. Il avait été écarté par le Sénat (voir ici le dossier analysé par France Générosités).
Une fondation qui a évolué de ouf
Difficile de savoir qui parle en regardant de loin ces affiches ultra colorées qui clament en gigantesques lettres ultra colorées : « Soyez une mère insup de ouf » ou « Soyez un daron super relou » pour inciter les parents à devenir plus intransigeants sur les usages des écrans de leurs enfants. Premières intuitions écartées : il ne s’agit ni d’une campagne gouvernementale, ni d’une campagne associative, mais de la première grande campagne « publicitaire » de prévention de la Fondation CNP Assurances.
Relayée par l’ensemble des médias dédiés à la communication (voir ici par exemple), cette campagne interpelle les parents, usant des codes des ados, pour les déculpabiliser dans leur guerre aux écrans. Mais elle interpelle aussi sur la place grandissante des fondations d’entreprises sur les questions de prévention. Dépassant de plus en plus leurs rôles initiaux de financeur de projets, elles ont gagné en maturité, en légitimité, en envie d’agir plus directement… voire de médiatiser cette action. Des évolutions qui appellent les fundraisers à repenser leurs liens et leur offre avec ces fondations.
La fondation CNP Assurances illustre bien le mouvement. Crée en 1993 et devenue fondation d’entreprise en 2011, elle a toujours été engagée en faveur de la santé. L’historique de ses communiqués de presse retrace la route : soutien à des CHU, à des projets de recherche, à des programmes de défibrillateurs cardiaques ou à des films documentaires dans les premières années. En 2015, lors de sa première prorogation, elle annonce renforcer sa mission et « intensifier son engagement avec pour axe prioritaire la réduction des inégalités sociales de santé ». L’heure est aussi aux partenariats : avec l’Agence du Service Civique (développement du service civique dans le domaine de la santé) et aussi avec l’Alliance pour l’Éducation (décrochage scolaire). D’autres suivront.
Fin 2024, nouveau cap, à l’occasion d’une nouvelle prorogation, cette fois la Fondation affine son positionnement, désormais « stratégique » et qui « marque une nouvelle page de son histoire », selon son communiqué. Désormais fondation Cet axe – : « Pour la santé des jeunes ». Engagée depuis sa création en faveur de la santé publique, cet axe s’inscrit dans la continuité de son action et souhaite marquer une nouvelle page de son histoire. L’occasion d’annoncer son soutien à un film documentaire écrit et réalisé par la réalisatrice Carole Bienaimé-Besse, « Les Écrans-Rois », illustrant justement l’impact des écrans sur la santé des jeunes. Une annonce suivie donc, quelques mois plus tard, du lancement de sa première campagne de sensibilisation, sur le même sujet.
Et aussi, dans l’actu de la quinzaine…
- Le Centre en philanthropie de l’Université de Genève lance l’Initiative Média et Philanthropie (IMP), pour réfléchir aux modèles de financement durable des médias par le don (le secteur suisse est en pleine restructuration). Le centre s’allie pour cela au pôle Médias de HEC Montréal avec en ligne de mire des réussites canadiennes comme celle de La Presse. En lire plus sur Cominmag.ch
- Insolite – Grâce à une collecte de près de 600.000 euros, cinq lions venus d’Ukraine (des “animaux de compagnie” détenus illégalement) trouvent refuge au Royaume-Uni. A lire notamment sur le Huffington Post.
- La générosité catalyseur de cohésion territoriale ? En Normandie, autour d’une initiative de collecte née pour Mayotte, l’engagement ne faiblit pas : concerts, événements sportifs ou festifs presque chaque semaine… Au-delà des 3000 euros de dons collectés, c’est surtout une dynamique territoriale festive et solidaire qui se déploie rapporte L’Orne combattante.
Cette veille a été publiée dans notre newsletter du 03 avril. Pour recevoir directement nos prochaines interviews, articles de veille, pensez à vous inscrire à la newsletter de l’AFF. C’est une manière simple de rester connecté à l’actualité du fundraising.
Rejoignez la communauté active des fundraisers sur tout le territoire
et boostez votre carrière au service du bien commun !